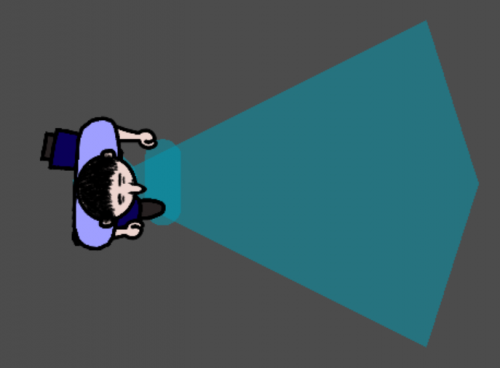Josef Koudelka : artiste itinérant. Un temps apatride de fait, il le demeura toujours dans l’âme – un choix qu’il revendique, assurant qu’on « ne rentre jamais d’exil ». Or, avant même l’exil effectif (en 1970), sa fascination pour les gitans, à qui il consacra sa première grande série, disait déjà quelque chose de son rapport au lieu. De même, si les êtres ont peu à peu disparu du champ de ses photographies, il faut moins y voir un changement d’intérêts qu’une révélation sur ce que, dès le départ, signifiait leur présence.
L’un des sujets de prédilection de Koudelka fut en effet toujours le lieu dans ses dimensions les plus problématiques et polémiques : l’appartenance ou la non-appartenance, les frontières en tension, les territoires en rupture.
Pourtant, il refusa toujours d’inscrire ses photographies dans un quelconque récit, jugeant que leur rôle n’est pas – ne doit jamais être – de raconter. C’est bien pour cette raison qu’il se refuse à donner des titres explicites à ses œuvres, préférant se contenter des noms de pays. Ce n’est que malgré lui qu’il dut fournir ceux, plus précis, des localités lors de la première publication de Gitans, en 1971 – et s’empressa de corriger ce point lors de la version de 2011, pour laquelle il fut beaucoup plus libre.
Lorsque, envisageant de faire paraître une partie de sa première série dans le magazine Life, Elliott Erwitt et Lee Jones lui demandèrent de confier les anecdotes derrière les clichés sélectionnés, ils n’obtinrent que l’autorisation d’ajouter un court texte sur l’histoire factuelle des Roms – soit de quoi aiguiser la sensibilité du spectateur, sans jamais l’orienter.
Ses photographies elles-mêmes, d’ailleurs, se soustraient à l’anecdotique. Elles privilégient une dimension théâtrale, où seule importe la pose, et donc seulement l’instant où est prise cette pose : non pas ce qui y a mené ni ce qui suivra. Ainsi le cliché évite-t-il le documentaire, en apparaissant détaché d’un plus large contexte.

CZECHOSLOVAKIA. 1956-1960. Polsko. 1958.
L’art de Koudelka se veut donc non anecdotique, non documentaire, non narratif… Est-ce à dire que ses photographies sont vides, ou purement esthétiques ? Anna Fávorá, historienne et critique d’art dont il fut proche, disait ainsi de ses premiers travaux qu’ils privilégiaient l’esthétisation sur le documentaire. Et néanmoins, Koudelka affirme une conception de la photographie qui va justement au-delà de la seule esthétisation. D’après lui, si « tout le monde peut appuyer sur le bouton » de l’appareil, « pour être un vrai photographe il faut avoir quelque chose à dire ».
Mais alors qu’est-ce que dire en opposition à raconter ? Où se situe une œuvre qui refuse aussi bien le narratif que le purement esthétique ?
Koudelka débuta sa carrière sur les planches d’un théâtre, en photographiant les acteurs durant leur répétition. Lorsqu’il put observer les tirages, la réaction d’Otomar Krejca, le metteur en scène de cette première pièce, fut de dire : « Tu mens. Tu mens car tu veux dire la vérité ». Par « mentir » sans doute signifiait-il ses choix, ici d’un cadrage extrêmement resserré, là d’un effet de flou, qui se faisaient nécessairement aux dépens d’une représentation globale et fidèle des scènes observées. Soit, précisément, son refus du documentaire. Il y aurait donc un mode de connaissance de l’événement qui tiendrait à autre chose qu’à une vérité première, évidente et objective (celle du documentaire), et qui nécessiterait le détour par une sorte de « mensonge » pour être transmise au spectateur.
C’est que, pour prendre ces photographies, Koudelka ne demeura pas extérieur au spectacle : au contraire, il monta sur scène, se mêla aux acteurs, s’imprégna de leurs mouvements au point de devenir lui-même partie intégrante de la troupe. Alors seulement, parce qu’il vivait le théâtre au lieu de se contenter de l’observer, il put en transmettre l’essence dans ses clichés. Là tient sans doute la nuance qui correspond à sa conception de la photographie : transmettre au lieu de documenter, dire au lieu de raconter.
Et ce fut ce même rapport qu’il appliqua dans toute la suite de sa carrière – regardant, depuis qu’il voyage, le monde lui-même comme un théâtre.
Dans sa série Gitans, ce ne sont ainsi pas les particularités culturelles qui l’intéressèrent, ni moins encore le témoignage de la misère ou du déracinement tel que pourrait l’attendre le public européen sédentaire. S’il y montre la vie quotidienne des Roms, ce n’est pas sous la forme du reportage, mais en abolissant au contraire la distance avec eux, en offrant le point de vue d’un membre même de cette communauté.

CZECHOSLOVAKIA. Slovakia. Bratislava. 1966. Gypsies.
« Photographier la vie » nécessite pour lui de participer à cette vie, d’être accepté par ceux qui la partagent. Alors semble surgir le principal paradoxe de Josef Koudelka : lui, l’éternel itinérant, l’exilé volontaire qui revendique comme un choix de n’avoir pas de « chez soi », affirme la nécessité d’appartenir dans une certaine mesure aux lieux qu’il ne fait pourtant toujours que traverser.
Mais le paradoxe n’est que de surface. C’est au contraire justement parce qu’il entretient la solitude et rejette toute attache définitive qu’il peut ainsi se mouvoir et s’intégrer parfaitement aux lieux qu’il rencontre. Plus qu’une posture artistique, il s’agit là chez lui d’une véritable éthique de vie.
« People say, « Oh, Josef, he is the eternal outsider, » but on the contrary I try always to be an insider, both as a photographer and as a man. I am part of everything that is around me. »
[« Les gens disent : « Oh, Josef, il s’exclut éternellement », mais au contraire j’essaie toujours de m’inclure, en tant que photographe et en tant qu’homme. Je fais partie de tout ce qui se trouve autour de moi. »]
L’exil n’est ainsi pas vécu comme la perte d’un lieu d’origine qui condamnerait à l’errance, mais comme l’opportunité de réellement vivre, pleinement, sans contrainte ni regret, en tout lieu sur la surface du monde.
« I didn’t want to have what people call a ‘home’. I didn’t want to have the desire to return somewhere. I needed to know that nothing was waiting for me anywhere, that the place I was supposed to be was where I was at the moment. »
[« Je ne voulais pas avoir ce que les gens appellent un ‘chez soi’. Je ne voulais pas avoir besoin de rentrer quelque part. J’avais besoin de savoir que rien ne m’attendait nulle part, que le lieu où j’étais censé être n’était autre que celui où je me trouvais. »]
C’est bien pourquoi, sans doute, il nomme sa série Exils : au pluriel et non au singulier. Parce qu’il ne dit pas l’exil comme un état, une expérience générale, mais ses exils dans leur multiplicité, leurs infinies variétés. Ainsi sa démarche et sa conception ne se rattachent pas à la patrie quittée, à partir de laquelle il vivrait un exil unique et uniforme, le même en tout autre lieu. Ce qu’il vit est au contraire une succession d’exils, tous singuliers : autant, en réalité, que de lieux vécus puis quittés.
Pour Josef Koudelka, photographier nécessite donc une connaissance intime du sujet, non pas intellectuelle mais empirique : il lui faut faire du lieu choisi son ‘chez soi’, certes éphémère, mais entier. Une fois vécue cette appartenance, la photographie peut être prise, car ainsi elle pourra dire l’affect développé, même brièvement, entre l’artiste et son sujet. Alors vient le moment du nouvel exil ; l’œuvre étant créée, l’appartenance effective ayant été immortalisée à travers l’image, l’artiste peut s’en « détacher complètement » :
« I wouldn’t talk about the photographs. I try to separate myself completely from what I do. I try to step back to look at them as somebody who has nothing to do with them. »
[« Je ne pourrais pas parler de mes photographies. J’essaie de me détacher complètement de ce que je fais. J’essaie de faire un pas en arrière et de les regarder comme quelqu’un n’ayant rien à voir avec elles. »]
Et il repart – en attendant la nouvelle appartenance, la nouvelle photographie, le nouvel exil.
Sources
— « La fabrique d’exils », exposition à la Galerie de photographies du Centre Pompidou, du 22 Février au 22 Mai 2017
— Images © Josef Koudelka / Magnum Photos
— Josef Koudelka, Nationality Doubtful, éditions Witkovsky, 2014
— Josek Koudelka: Exiles, éditions Aperture, 2014
— « Josef Koudelka : Prague 68 », émission « Hors-champs » du 17 février 2016 sur France Culture, avec Laure Adler
— « La chambre noire de Josef Koudelka », émission « La Grande Table » du 22 février 2017 sur France Culture, avec Olivia Gesbert
— « 40 years on: the exile comes home to Prague », Sean O’Hagan pour The Guardian
— « “We Are All the Same”: A Conversation with Josef Koudelka », Laura Hubber et Annelisa Stephan pour The Iris